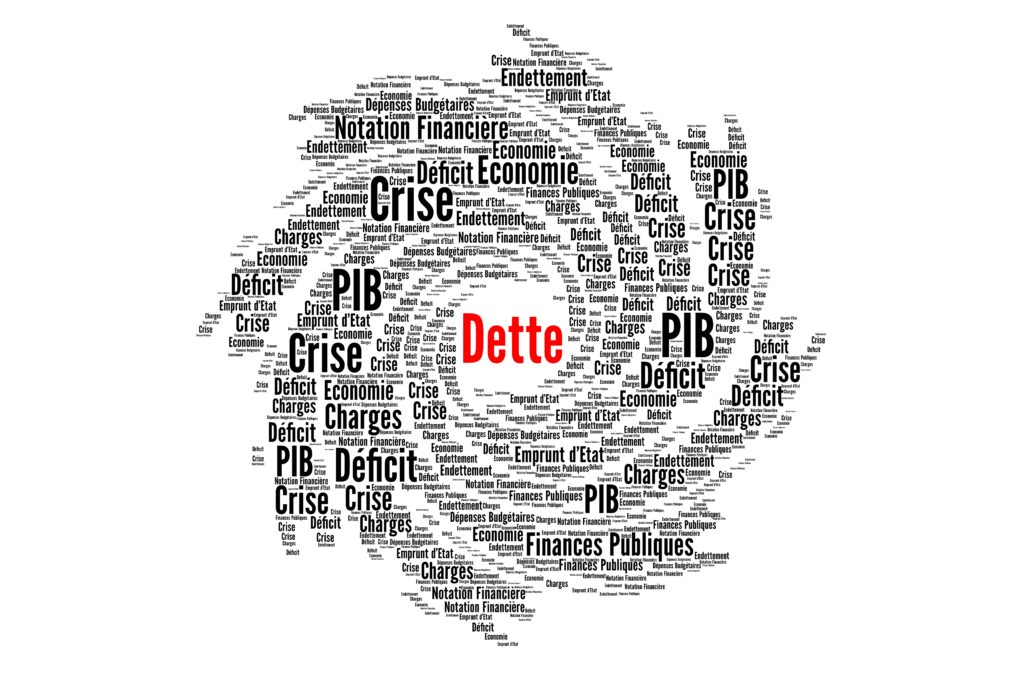La France dépense pour vivre, et vit pour dépenser ; près d’un euro sur deux versé aux ménages vient de l’Etat ou de la Sécurité sociale. Une richesse circulaire, entretenue par la dépense publique plus que par la création de valeur réelle.
Pour décrypter les dérives budgétaires de la France et leurs conséquences, découvrez France en Faillite, la newsletter des Publications Agora, signée Ionès Jaoulane.
On aime se dire que la France est riche. Mais si on gratte un peu, cette richesse tourne en rond. Elle ne vient plus vraiment de la production, du commerce, ni de l’innovation. Non. La France vit de sa propre dépense.
Travailler pour payer ceux qui travaillent pour l’Etat
En 2023, selon l’Insee, 21 % des salariés français travaillent dans le secteur public : fonctionnaires, enseignants, personnels hospitaliers, territoriaux, militaires… Plus d’un salarié sur cinq. Et ça coûte cher. Cet argent vient du reste du pays, de ceux qui produisent, exportent, vendent, innovent. Autrement dit, le privé finance le public… qui alimente le privé par la dépense. Une boucle fermée. Chaque euro dépensé par l’Etat est un euro pris à quelqu’un d’autre, recyclé, puis redistribué comme s’il s’agissait d’une richesse nouvelle.
Les chiffres 2023 de l’Insee sont limpides :
- revenus d’activité nets des salariés du secteur privé et autoentrepreneurs : 882 Md€ ;
- revenus d’activité nets des salariés du secteur public : ≈ 189 Md€ ;
- prestations sociales et retraites : 595 Md€.
Au total, 47 % du revenu des Français (hors revenu du patrimoine) est versé par l’Etat. (Les cotisations sociales atteignent 547 Md€.)
Un pays qui se paie avec sa propre monnaie fiscale
Les prestations sociales (retraites, aides, allocations, RSA, AAH, APL…) dépassent 595 Md€ par an. Le secteur privé, lui, s’étiole. Moins d’embauches, moins d’innovation, fiscalité parmi les plus lourdes d’Europe. Résultat : les recettes fiscales stagnent, mais la dépense publique continue de croître. On alimente la consommation par la dépense publique, qui crée de la TVA, qui remplit les caisses… pour dépenser à nouveau. Un serpent économique qui se mord la queue.
La vraie question n’est plus : « Combien gagne la France ? » Mais : « Qui crée encore la richesse initiale ? » Le privé crée la valeur, l’Etat la prélève, puis la redistribue pour entretenir la demande, qui justifie à son tour de nouvelles dépenses. Circuit bouclé. Mais fermé. Qui tourne sur lui-même sans moteur externe.
La France, en 2025, n’est pas en ruine, elle est en apnée. Elle respire son propre air fiscal, recycle sa richesse interne, et croit vivre. Si le secteur productif ralentit encore, le miroir se brisera. Une grande part de notre prospérité n’était qu’une illusion comptable, alimentée par la dépense publique. La France ne produit plus sa richesse : elle se la verse.
Près de la moitié du PIB français est générée par la consommation des ménages : alimentation, logement, transport, loisirs, services…
Les prélèvements obligatoires représentent 42,8 % du PIB en 2024. C’est l’argent que ménages et entreprises versent à l’Etat, aux collectivités ou à la Sécurité sociale pour faire tourner la machine publique.
L’illusion des économies affichées par des politiques qui ne sont pas économistes
Voici un exemple extrême pour montrer que couper un euro de dépense ne réduit pas toujours le déficit d’un euro.
Admettons que l’Etat réduise de 10 % certaines dépenses majeures, comme les salaires nets du secteur public (189 Md€) ou les prestations sociales et retraites (595 Md€), cela représenterait environ 79 Md€ en moins.
Sur le papier, économie massive. En pratique, ce n’est pas si simple. Les salariés du secteur public et les bénéficiaires des prestations sociales et retraites dépensent cet argent dans l’économie, générant à leur tour des recettes fiscales et sociales à hauteur de 42,8 %. Concrètement, retirer 100 € d’une prestation fait perdre 42,8 € de recettes à l’Etat. L’économie réelle pour l’Etat n’est donc que de 57,2 € par 100 € coupés.
Pour nos 79 Md€ de réduction :
- recettes fiscales perdues ≈ 34 Md€ ;
- économie nette réelle ≈ 45 Md€.
Pourquoi ? Parce que le secteur public occupe une place immense dans l’économie. Salaires publics et prestations constituent une part majeure du revenu disponible. Toute coupe directe réduit la consommation globale et le PIB. Comme les recettes fiscales dépendent du PIB, l’Etat voit ses rentrées diminuer l’année suivante. Sur le papier, l’Etat coupe 100 € ; dans la réalité, l’économie perd 42,8 € de recettes. Un cycle invisible que beaucoup de politiques semblent ignorer.
Derrière le problème français… se cache aussi un problème européen
Au‑delà de nos frontières, il existe un autre frein : le dumping fiscal et social au sein de l’Union européenne. Certaines entreprises vendent en France, mais paient leurs impôts dans un autre pays de l’UE où la fiscalité est plus faible. La France ne peut pas agir seule : toute mesure fiscale ou protection commerciale doit passer par la Commission européenne. Elle peut toutefois négocier au sein de l’UE, imposer des règles communes ou demander des sanctions contre le dumping.
Il en va de même pour les barrières douanières : la France ne peut pas les mettre unilatéralement contre les pays tiers. Mais via l’UE, elle peut soutenir des droits anti-dumping ou des mesures de protection commerciale contre des importations injustement subventionnées.
Notre vrai problème n’est pas seulement externe. La France doit composer avec les règles européennes, le dumping social intra-UE et la fiscalité différenciée entre Etats membres. On montre souvent du doigt les pays hors UE, mais une part importante de la pression économique vient aussi de l’intérieur de l’Union.
La France continue donc de vivre d’elle-même. Mais si le moteur productif faiblit, le souffle pourrait bien manquer…