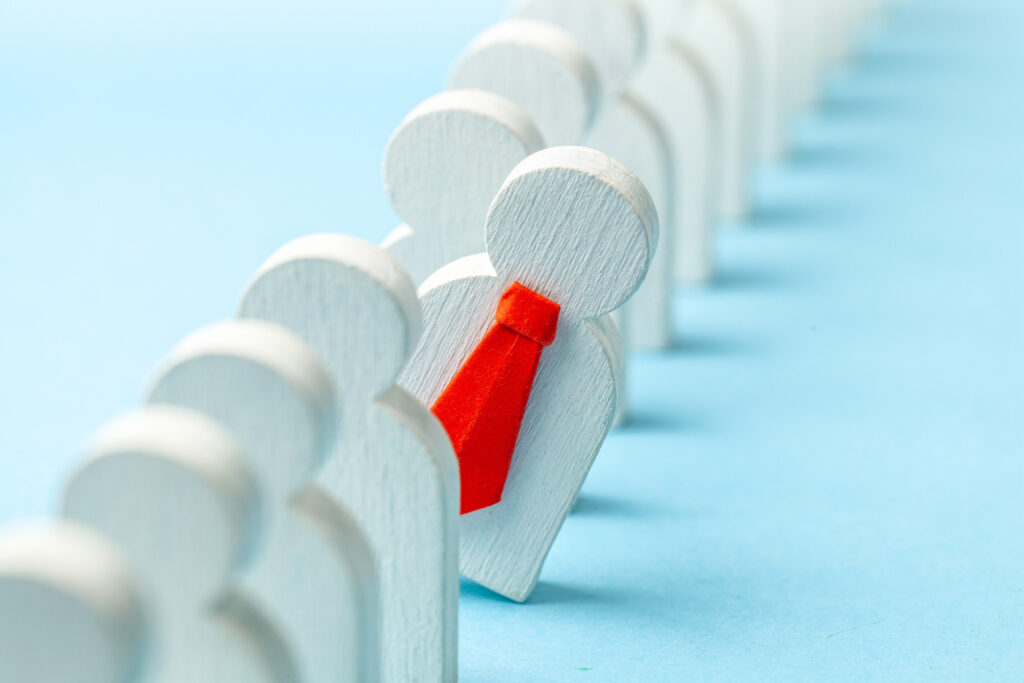Deux chocs majeurs secouent l’actualité : d’un côté, les chiffres de l’emploi américain (NFP) qui font vaciller le dollar et propulsent l’or et l’argent à des records historiques ; de l’autre, un scandale politico-médiatique qui dévoile au grand jour la collusion entre journalistes influents du service public et le Parti socialiste.
Cette chronique, c’est la combinaison de deux séismes qui vont transformer notre quotidien économique et médiatico-politique.
Je traiterai d’abord du NFP (ou rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis), qui a clairement fait basculer les anticipations en matière de politique monétaire de la Fed – mais également du scandale de ce « complot » de deux journalistes vedettes intervenant quotidiennement sur France Inter et sur France TV (en compagnie de deux journalistes de Libé) s’engageant à user de leur influence dans le service public pour favoriser le destin politique de Raphaël Glucksmann, tout en torpillant la campagne d’une élue de droite à la mairie de Paris.
Ce scandale rend soudain visible non plus une connivence qui mord sur la ligne jaune, mais la collusion entre la médiasphère, majoritairement de gauche, et le PS ; puis la totale absence de déontologie de journalistes « faiseurs d’opinion », jugeant naturel depuis des années de « rouler pour des personnalités de leur bord », de se livrer à de la propagande, voire à de la diffamation contre les candidats de « l’autre bord » (sans leur offrir le moindre droit de réponse et en appelant à les priver de temps de parole)… le tout avec l’argent des contribuables.
Mais commençons par la thématique du marché du travail aux Etats-Unis : cela fait des mois que l’éléphant déambule dans le corridor, hoche la tête, balance sa trompe, raye la peinture et le dallage avec ses défenses – il fait vraiment tout ce qu’il peut pour se faire remarquer – mais les médias font comme s’il n’était même pas là. Car la croissance a été calculée à +3,3 % au 2ᵉ trimestre (la productivité affiche un score identique), la consommation tient bon (+0,5 % en août) et les recettes douanières s’empilent comme jamais depuis 1971.
Il y a donc un double positionnement des acteurs du marché US depuis la reprise en « V » de début avril, qui plaide dans les deux cas pour une hausse inexorable de Wall Street (eh oui, il faut un narratif puissant pour soutenir une valorisation des actions qui surpasse les niveaux de 2000 ou 1929) : du coup, les nouvelles sont toujours bonnes.
Si les chiffres sont « plus robustes que prévu », c’est que la croissance tient bon : aucun risque de récession, c’est bon pour les profits des entreprises.
Si les chiffres sont « pires que prévu » – et les signaux de faiblesse du côté de l’emploi se multiplient depuis sept mois – alors cela va amener la Fed à baisser ses taux… et ça, c’est bon pour la prime de risque associée aux actions.
Elles se payent « un peu cher », mais avec un coût de l’argent abaissé, ça pourrait tenir sans corriger sévèrement, et c’est exactement ce qui se passe depuis la mi-mai : une consolidation à l’horizontale en Europe, une hausse lente mais inexorable à Wall Street, et trente records absolus sur le S&P 500.
Le paradoxe d’un marché du travail qui se dégrade – quelle que soit la façon de l’analyser – et la conviction que la conjoncture demeure porteuse, c’est le niveau apparemment élevé de la consommation, laquelle résulte de « l’effet de richesse » entretenu par des indices boursiers qui battent record sur record… inexorablement.
Mais cet « effet de richesse » ne concerne réellement qu’une minorité d’Américains plutôt fortunés.
Pour 80 % d’entre eux, la problématique, c’est la difficulté de se loger ou de s’agrandir, car l’immobilier est devenu inabordable ; ce sont des voitures qui coûtent plus cher et que l’on change moins souvent, des frais de scolarité astronomiques, des encours de carte de crédit qui gonflent à des niveaux jamais observés, et des emplois qui se précarisent.
En effet, le système de comptage des emplois du BLS, c’est de considérer que chaque embauche compte pour un emploi supplémentaire, que ce soit à plein temps, à mi-temps ou à quart temps.
Et le chômeur qui obtient un travail cesse ainsi d’être chômeur, qu’il bosse dix heures ou quarante heures par semaine.
Et pour ajouter encore à cette forme de prestidigitation statistique, les chiffres « bruts » dévoilés chaque mois sont presque systématiquement surestimés (ouf, la croissance reste créatrice d’emplois !), puis révisés à la baisse le mois suivant (ouf, tout le monde a oublié les précédents !).
Et avec cette psychologie du verre à moitié plein, très américaine, les chiffres « meilleurs que prévus » (même complètement fictifs) éclipsent la réalité de chiffres nettement moins bons qu’annoncés un mois auparavant (révision de -120 000 en mai, -160 000 en juin).
Ainsi, en faisant le cumul des révisions à la baisse (ce fut le cas chaque mois cette année, sauf en juillet avec un modeste +6 000), Wall Street s’est réjoui mois après mois de plus de 600 000 créations d’emplois… qui n’ont jamais existé !
Non seulement cela, mais le nombre d’emplois à plein temps a fondu de 357 000 au mois d’août, et cela a été contrebalancé par +597 000 boulots à temps partiel, majoritairement à durée déterminée : le solde donne seulement +22 000 emplois, car beaucoup ont été préemptés par des Américains qui avaient déjà un autre job temporaire ou qui ont obtenu une prolongation de mission (même boîte, même job, mais nouvelle offre selon les critères du BLS).
L’autre signe de dégradation – non seulement qualitative mais aussi quantitative – c’est le recul global des offres d’emploi : le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) s’est contracté de près de -170 000 à 7,181 millions d’offres en juillet, contre 7,357 millions en juin, et de -1,6 million en 2 ans.
Enfin, si le nombre de licenciements ou de séparations amiables est demeuré stable (par peur de ne pas retrouver un bon emploi), en revanche, le nombre de réembauches après une « rupture » est en nette baisse, d’où la chute du temps plein.
Ces chiffres, la Fed les connaît, ainsi que ceux qui pariaient sur trois baisses de taux d’ici fin 2025 : l’attente fut longue, l’inflation, qui ne se contracte plus, agit comme un vent contraire puissant. Mais avec le NFP du mois d’août, le scénario d’un loyer de l’argent à 3,50 %/3,75 % d’ici mi-décembre semble en passe d’être gagné : le baromètre Fed Watch traduit une quasi-unanimité pour une baisse de 25 pts en septembre et lors de la dernière réunion annuelle de décembre ; pour fin octobre, le consensus grimpe pratiquement à 60 %.
D’où la forte détente de -10 pts des taux US vendredi 5 septembre, puis le plongeon de -0,7 % du dollar, qui enfonce la base de son canal de consolidation estival (97,7/98,8 pour le $-Index).
Nous évoquerons demain le double record absolu de l’or et de l’argent, qui progressent plus vite que le billet vert ne recule.