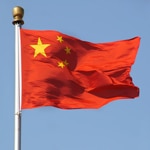▪ La plupart des opérateurs avaient parié depuis une bonne semaine sur une séance calme à l’occasion de la célébration de Yom Kippour par nombre d’intervenants sur les marchés financiers. Mais les places européennes subissent paradoxalement leur plus lourd recul en une seule séance depuis le 2 août dernier. Jugez plutôt : -2,7% pour l’Euro-Stoxx 50 qui enfonce le seuil des 2 500, dans le sillage de Milan en chute libre de 3,3% ou de Madrid qui dévisse de 3,95%.
Une fois n’est pas coutume depuis le milieu de l’été, ce sont les vendeurs qui ont pesé sur le fixing de clôture. Le CAC 40 est passé de -2,45 à -2,82% pour une clôture au plus bas du jour à 3 415 points (soit 100 points sur cette seule séance de mercredi), avec des volumes se gonflant de 2,4 milliards à 3,2 milliards d’euros.
L’accélération baissière de cette fin de séance est probablement de nature plus technique que fondamentale, d’autant que Wall Street se montrait plus que résistant au moment de la clôture des places du Vieux Continent (-0,5% en faisant la moyenne du S&P et du Nasdaq).
▪ Les places asiatiques sombrent dans le rouge
Des écarts qui apparaissaient bien modestes en regard de ceux observés quelques heures plus tôt à Tokyo (-2%) ou à Shanghai (-1,25%).
La première place financière chinoise (la troisième mondiale en termes de capitalisation boursière, derrière Wall Street puis Tokyo/Osaka) a même effectué mercredi matin une incursion sous les 2 000 points. Ce niveau plancher n’avait plus été approché depuis début mars 2009.
Nous pourrions considérer qu’il s’agit d’une opportunité de voir se développer un rebond — au moins technique. Mais les investisseurs chinois semblent se méfier de la contribution des banques à l’apport de richesse additionnelle, laquelle avoisine 60% des gains déclarés par l’ensemble des entreprises cotées — de mémoire, le secteur automobile ne représente pas plus de 5% du total.
Imaginons — mais ce n’est qu’une supposition sans le moindre commencement de preuve matérielle — que les banques chinoises surestiment la rentabilité des capitaux prêtés aux agents économiques et sous-estiment le montant des créances douteuses qui s’accumulent depuis la crise de 2009. Il se pourrait — et nous insistons bien sur ce conditionnel — que leur valorisation boursière soit (fortement) revue à la baisse. Auquel cas Shanghai n’aurait pas fini de corriger.
▪ Pékin devra-t-il refinancer ses banques ?
Imaginons maintenant — mais rassurez-vous, il s’agit assurément de pure science-fiction — que certaines banques chinoises se débattent avec des bilans aussi compliqués (désastreux et inavouables) que ceux des banques espagnoles en 2012, britanniques en 2008, ou japonaises en 1990. Cela pourrait contraindre Pékin à les refinancer sans trop tarder.
Pas question de perdre la face sur la scène financières internationale en regardant les bras ballants certains établissements faire faillite comme aux Etats-Unis dès le printemps 2007, en prétendant qu’il s’agit d’incidents isolés et que la situation reste sous contrôle.
En Chine, le mot d’ordre est d’abord de reprendre le contrôle, puis de communiquer sur le sujet s’il s’avère impossible de faire autrement.
Pour notre tranquillité d’esprit, il serait bon que personne ne songe à creuser la question au cours des prochaines semaines. Mieux vaudrait également que personne ne se demande d’où Pékin va sortir les 125 milliards de dollars supplémentaires prévus pour financer son programme de dépenses d’infrastructures en 2013.
Tout le monde connaît d’ailleurs la réponse : de ses gigantesques réserves de liquidités !
▪ Un trésor… qui n’a pas la valeur que l’on pense
Mais au fait, de quoi ce trésor de guerre estimé à 3 200 milliards de dollars est-il constitué ?
C’est le moment de changer de sujet sinon quelqu’un va nous envoyer un e-mail pour nous rappeler que cet argent est investi à 70% en bons du Trésor américain. Un ratio qui n’évolue plus depuis près de trois ans car la Chine a opté pour une stratégie de panachage avec l’euro, le yen et la livre sterling.
Les excédents commerciaux se contractant au fil des mois, Pékin réduit symétriquement ses achats de bons du Trésor. Pendant ce temps, les besoins de financement des Etats-Unis ne cessent de s’accroître à l’approche de la falaise fiscale qui s’impose en tache de fond comme l’épée de Damoclès de l’après-présidentielle de novembre.
▪ Les Etats-Unis : le Monaco américain
Wall Street y est particulièrement attentif puisque d’importantes réductions d’impôts, concernant entre autres les dividendes et les gains en capital, viennent à échéance le 31 décembre. C’est grâce à ces dispositions accordées par l’administration Bush que les riches sont devenus ultra-riches (Mitt Romney n’est imposé qu’à 15%), et que les ultra-riches font exploser la quantité de capitaux dédiés aux fondations à but non lucratif… et exemptées à ce titre de toute fiscalité sur leur patrimoine et sur les flux de liquidités qu’elles génèrent.
Depuis la mise en oeuvre du Tax Reform Act de 1969, les fondations (qui peuvent être administrées par les donateurs ou par une fiducie) sont soumises à une taxe de… 1% ou 2% sur les revenus que leur procurent leurs placements. Pas la peine d’émigrer fiscalement à Monaco : certains comme les John D. Rockefeller et autres Andrew Carnegie l’ont compris depuis près d’un siècle !
Depuis que leur nombre a dépassé les 100 000 au cours des années Bush, elles ont été rebaptisées « philanthrocapitalistes » par The Economist et sont clairement utilisées comme outils de défiscalisation de nombreux placements financiers, détournant l’esprit de la fondation telle qu’elle figure dans les lois fondatrices datant de l’immédiat avant Première guerre mondiale.
▪ Les Etats-Unis sont bien loin des idéaux des pères de la nation
Pour s’assurer leur pérennité, de nombreuses fondations financent des universités et des think tanks qui assurent la promotion d’une pensée économique d’inspiration très libérale — pour ne pas dire le plus souvent ultra-libérale — où l’Etat et l’impôt sont présentés comme les ennemis du business et de la création de richesse.
Il se trouve que la plupart des élites politiques américaines ont été formées ou voient leur carrière sponsorisées par des fondations dont le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne prônent plus guère la réalisation du contrat social conçu par les pères de la nation deux siècles auparavant.
Il est vrai que pas mal d’eau a coulé sous le pont de Brooklyn depuis la création de la Fed en 1913 — un événement qui a dû faire se retourner Abraham Lincoln dans sa tombe — et la société américaine est devenue depuis une décennie la plus inégalitaire de son histoire.
C’est surtout l’inégalité devant l’impôt qui explique pourquoi les classes moyennes se paupérisent à un rythme jamais observé depuis 1929. La charge de la dette de 15 000 milliards de dollars que les Etats-Unis sont désormais incapables de rembourser repose majoritairement sur ceux qui n’ont aucun moyen d’échapper à la fiscalité… sauf en basculant dans l’ultra-pauvreté.
Qu’on se rassure, ils sont désormais 46 millions dans cette situation et leur pourcentage progresse aussi rapidement que celui des millionnaires accédant au statut de milliardaires.